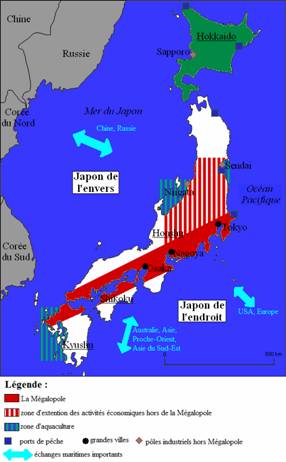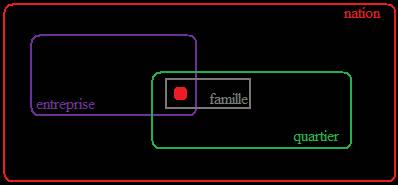|
|
||
|
Après avoir parlé de la seconde guerre mondiale (cf. dossier correspondant), voici
maintenant un dossier sur le Japon. Vous trouverez ci-contre une carte
présentant le dynamisme de l’espace japonais. Vous pouvez cliquer sur les
images pour les agrandir. |
||
|
Introduction : Un archipel très peuplé I/ Le cadre naturel Archipel formé de plus de 3 400 îles, le Japon domine un territoire beaucoup
plus grand que sa simple surface terrestre : ses limites maritimes légales
multiplient en effet sa surface par douze. Le territoire est composé de
plaines littorales rare et exiguës, tandis que l’intérieur est dominé par des
montagnes élevées. II/ La croissance et la répartition de la population Les quatre plus grandes îles abritent la quasi-totalité des 126
millions de Japonais. La densité moyenne est élevée (355 habitants par km²)
mais les deux-tiers de la population occupent 3% du territoire. Première partie : Géographie du Japon A- Les Japonais sur leur territoire I/ Une population inégalement répartie Le territoire japonais est contraignant : il est fragmenté
en quatre îles principales et 3 400 autres îles ; il possède peu
d’espaces plats : les trois-quarts du pays sont dominés par des
montagnes aux pentes souvent abruptes alors que les plaines, étroites, sont
limitées au littoral. C’est aussi une terre à hauts risques : aux
typhons et éruptions volcaniques (77 volcans actifs) s’ajoutent |
||
|
les nombreux séismes (séisme de Kobe en 1995) et les tsunamis. La population japonaise, qui comprend 126 millions d’habitants, est
très inégalement répartie. Les densités humaines sont très fortes dans les
plaines littorales de la façade pacifique. Les villes de cette région
sont immenses et constituent la plus grande mégalopole du monde. II/ La concentration littorale des activités Le littoral concentre depuis longtemps la plupart des activités
économiques du Japon (agriculture, pêche, industrie). Le Japon est
le troisième producteur mondial de produits de la mer et l’aquaculture
a une grande importance. Durant la Haute croissance, l’industrie s’est développée dans les
grandes baies du littoral pacifique, pour bénéficier de l’importation des
matières premières dont manque le Japon et pour rendre plus facile les
exportations. On y a édifié des terre-pleins pour les usines
sidérurgiques et pétrochimiques alors que les autres industries (notamment
l’automobile) essaimaient en arrière du rivage. Un immense ruban
industriel littoral s’est ainsi constitué sur la façade pacifique,
à l’origine de la Mégalopole. Les nouvelles industries de haute technologie, qui ont besoin
de peu de matières premières, s’implantent aujourd’hui dans l’arrière-pays,
non loin de la Mégalopole. III/ La maitrise d’un territoire contraignant Le territoire japonais est très contraignant, mais peu à peu les
Japonais ont réussi à la maîtriser : - Les terre-pleins pour les industries mais aussi de plus en
plus pour les activités de services (administrations, loisirs, commerce) ou
les résidences permettant de pallier le manque de place dans les plaines. - De grands ouvrages d’art ont été construits pour unir
les grandes îles entres elles : ponts géants ou tunnels sous-marins (le
plus grand tunnel sous-marin du monde, de - Enfin, la population est sensibilisée aux risques naturels et les constructions
tiennent compte du danger sismique (immeubles bas ou procédés de construction
antisismiques). |
||
|
B- Un espace
contrasté I/ La Mégalopole, région motrice de la puissance
japonaise Ruban urbain de La première conurbation mondiale (Tokyo-Yokohama-Kawasaki) est
le cœur de la Mégalopole. Capitale politique du pays, Tokyo monopolise les activités
de commandement. Cependant, malgré sa puissance, elle n’a pas le
rayonnement de New York. II/ Les déséquilibres d’un espace ouvert sur le monde |
||
|
Le territoire japonais est marqué par de très forts contrastes
régionaux. Au « Japon de l’endroit », ouvert sur le
monde et où se concentrent les hommes et les activités, s’oppose le « Japon
de l’envers ». La Mégalopole, le centre
du Japon appartient au « Japon de l’endroit » alors que le
« Japon de l’envers » comprend presque toutes les périphéries. Tokyo appartient aux métropoles majeures de la planète et sa région,
le Kanto, est le cœur économique japonais. Cependant, Osaka, second pôle
national, concurrence Tokyo depuis les années 1980. |
||
|
Seconde partie : Economie du Japon A- L’édification d’une puissance I/ Le « miracle économique » En 1945, le Japon est vaincu, ruiné et occupé par les USA. Mais il se
reconstruit rapidement. En 1951, grâce à l’aide des Etats-Unis, il a retrouvé
son niveau de production d’avant-guerre ; puis il connaît jusqu’en 1973
la plus forte croissance économique du monde (10% en moyenne par an) :
c’est la période dite de « Haute croissance ». La croissance
reste forte jusqu’à la fin des années 1980 (5% par an), date à laquelle le
Japon entre dans une période de récession. Le Japon est ainsi devenu la seconde puissance économique, la seconde
puissance industrielle, et la troisième puissance commerciale du monde. II/ Les atouts de la puissance La main-d’œuvre japonaise est très efficace et dévouée. Son
haut niveau d’instruction lui permet de s’adapter rapidement aux changements
technologiques. Les entreprises sont performantes : - Les grandes entreprises, regroupées dans les conglomérats ou
kereitsus, investissent beaucoup dans les technologies les plus
récentes et la recherche. Des sociétés de commerce spécialisées, les sogo-shoshas,
les renseignent sur les attentes des marchés extérieurs et se chargent de
commercialiser leurs produits. - Les petites entreprises sous-traitantes répondent rapidement
à la demande des grandes entreprises. L’Etat joue un rôle
moteur dans l’économie en particulier à travers le Ministère de l’industrie
et du commerce international (MITI). Il donne des informations aux
entreprises, accorde des aides financières aux secteurs industriels
d’avenir, aide la recherche, investit dans les infrastructures (ports,
voies ferrées, …). Ces dépenses sont permises grâce à la relative faiblesse
du budget militaire. III/Une puissance incomplète Le Japon reste une puissance politique et militaire encore
secondaire. La Constitution de 1946, rédigée sous l’autorité des USA, en a
fait un pays démocratique mais en même temps limité sur le plan extérieur
(limitation de l’armée et de l’armement) et il n’a donc pas l’arme nucléaire
et sa diplomatie se calque encore souvent sur celle des Etats-Unis (qui
possède des bases militaires dans le pays). Le Japon a aussi une influence culturelle réduite. Sa langue et
son mode de vie ne se sont pas exportés. Les japonais sont même largement
américanisés (importance du base ball et du golf, diffusion des séries
télévisées américaines,…). B- La seconde puissance économique I/ Une industrie puissante à la pointe de l’innovation Le Japon, avec 15% de la production mondiale, est la seconde
puissance industrielle derrière les Etats-Unis : - les industries de base (sidérurgie, pétrochimie…) et la construction
navale, avec 40% de la production, sont très puissantes. Mais elles souffrent
de la croissance de la production mondiale et de la concurrence des nouveaux
pays industrialisés d’Asie. - L’automobile reste un fleuron de l’industrie japonaise :
le Japon est le second producteur mondial d’automobiles. Toyota
fournit plus du tiers de la production nationale. - Les industries de haute technologie sont le point fort du
Japon : elles représentent plus du quart de la production nationale et
progressent fortement dans tous les domaines (matériel électronique,
télécommunications robotique, nouveaux matériaux, biotechnologie). II/ De très forts excédents commerciaux Avec 9% des échanges internationaux, le Japon est la troisième
puissance commerciale, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne. Ses
principaux partenaires commerciaux sont les Etats-Unis, les pays
d’Asie du Sud-Est et l’Union européenne. Le Japon exporte des produits industriels notamment des automobiles,
des machines, du matériel électrique et électronique. Comme il a très peu de ressources naturelles, il
importe beaucoup de matières premières minérales ou énergétiques (prés
de 100% de sa consommation de fer, de charbon, ou de pétrole) ; il
achète aussi beaucoup de produits agroalimentaires. La balance commerciale du Japon est très excédentaire.
Pourtant les exportations ne représentent que 10% de la production japonaise.
En fait, les excédents sont surtout dus à la faiblesse relative des
importations, liée à la protection du marché intérieur (réglementations
diverses…) et à la faible attirance des japonais pour les produits étrangers. III/ Les capitaux japonais gagnent le monde Depuis les années 1980, les entreprises industrielles et de
services japonaises se délocalisent notamment aux Etats-Unis et
dans l’Union européenne pour se rapprocher de leur clientèle et éviter
les barrières douanières, et en Asie du Sud-Est ; Toyota a ainsi
créé récemment une usine en France, à Valenciennes. Cependant, la part de la
production industrielle à l’étranger ne représente que 10% du PNB contre 19%
pour l’Allemagne et 23% pour les Etats-Unis. Le Japon est aussi le premier
fournisseur d’aide publique au développement (surtout vers l’Asie) et prête
des capitaux au monde entier. C- La société japonaise, facteur de la réussite
économique I/ Une société soudée et hiérarchisée La société nippone est fondée sur des rapports hiérarchiques entre
les individus qui sont inclus dans divers groupes, comme la famille ou
l’entreprise. La priorité donnée au groupe par l’individu garantit un ordre
social où les revendications personnelles sont mineures. II/ L’individu s’identifie par rapport au groupe L’individu (matérialisé par le point rouge sur le schéma) est une
petite pièce au sein d’un vaste puzzle. Le groupe est présent à tous les
échelons de la vie. Les devoirs de l’individu envers la communauté sont
considérables : prendre soin de ses parents âgés, veiller à la qualité
de vie du quartier, contribuer à la réussite de l’entreprise ou consommer des
produits japonais. III/ De l’école à l’entreprise : la soumission à un
modèle de société Amour du travail bien fait, faible absentéisme et dialogue entre
patron et ouvriers sont présentés comme les qualités des entreprises
japonaises. Les salariés donnent beaucoup car ils s’identifient à leur
entreprise. Mais pour y entrer, dés l’école, les Japonais sont confrontés à une
rude compétition. Ce modèle de société est aujourd’hui rejeté par une
partie de la jeunesse. D- Le Japon, au cœur de l’Asie-Pacifique I/ Le Japon, modèle pour l’Asie-Pacifique ? Les relations entre le Japon et ses voisins ont longtemps été tendues
à cause de la politique d’expansion japonaise de la première moitié du
siècle. S’il inquiète, le Japon fascine par sa réussite
économique : premier pays non occidental à s’être industrialisé, il est
apparu comme un modèle de développement à suivre. Les Nouveaux Pays
Industrialisés d’Asie (NPIA) ont suivi les mêmes étapes
d’industrialisation (de l’industrie textile aux in industries de base puis à
la haute technologie) et utilisé des moyens proches de ceux du Japon
(main-d’œuvre efficace, grandes entreprises, actions motrices de
l’Etat) ; leurs économie concurrencent désormais celle du Japon. La
Chine et d’autres pays d’Asie du Sud-Est se développent à leur tour. Le Japon
est au cœur d’une zone en développement rapide. II/ Une dépendance croissante de économies Dans le domaine commercial, les liens du Japon avec les pays de
l’Asie-Pacifique s’intensifient depuis les années 1970 : 42% de
ses exportations et 36% de ses importations sont réalisées avec ces pays. Le
Japon leur achète des matières premières et de plus en plus de bien
industriels du fait de leur développement économique ; il leur exporte
de plus en plus de ses produits industriels grâce à la croissance rapide de
leur niveau de consommation. Les entreprises japonaises investissent de plus en plus dans la région
pour profiter d’une main-d’œuvre moins coûteuse mais aussi parce que ces pays
sont des marchés importants (Corée du Sud) ou d’avenir. Depuis les années
1990, les entreprises japonaises ont ainsi créé de nombreuses filiales
dans l’Est de la Chine. Le Japon et l’Asie du Sud-Est ont désormais des économies très
dépendantes. Ainsi, la crise économique de 1997 en Asie du Sud-Est
a réduit les exportations japonaises et entraîné des difficultés pour ses
filiales industrielles. III/ Les japonais regardent vers l’Asie Depuis la fin du XIXe siècle, le Japon est surtout fasciné par
l’Occident. Mais aujourd’hui, l’Asie-Pacifique éveille l’intérêt des
japonais : ils s’y rendent plus nombreux en vacances, les livres sur
l’Asie se multiplient, les échanges culturels s’intensifient (accueil d’étudiants
asiatiques). En même temps, le Japon améliore ses relations diplomatiques
avec les pays d’Asie, il commence à reconnaître les crimes de la Seconde
Guerre Mondiale et il a renforcé ses relations avec la Chine. Il espère jouer
un rôle politique régional important dans l’avenir. Vous pouvez réagir à cet article sur le forum en cliquant ici. |
||